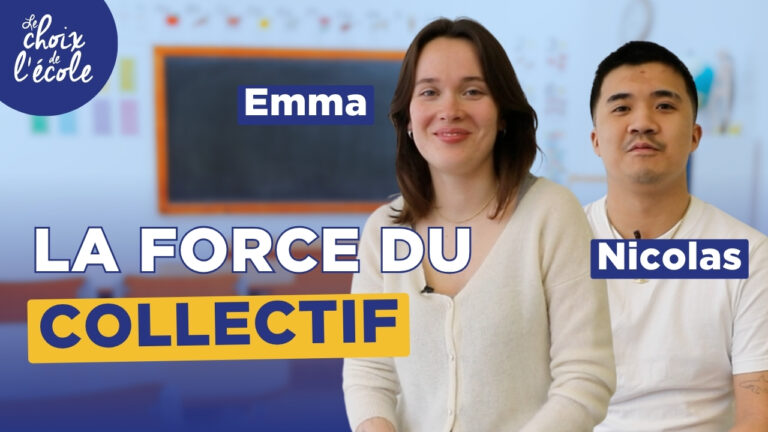Pascal Clerc, géographe et professeur à l’Université de Cergy, était l’invité du Choix de l’école pour la conférence de rentrée du 10 octobre 2024. Il nous a partagé ses réflexions sur l’école en tant qu’espace, regroupées dans son livre Émanciper ou contrôler sorti le 28 août 2024 aux éditions Autrement. Ses propos soulignent une dichotomie de l’école – à la fois lieu fermé, avec des règles strictes, et lieu qui veut préparer à l’ouverture au monde – qui se révèle particulièrement intéressante lorsque l’on se penche sur les établissements scolaires, leur architecture, leur organisation dans l’espace.
Cette réflexion de Pascal Clerc part d’une question : pourquoi retire-t-on du monde les enfants pour les enfermer dans les écoles, alors que le but de l’école est de préparer au monde ? Quel sens cela a-t-il ? Cela permet-il une école réellement émancipatrice ? Ou cela ne relève-t-il pas d’autre chose, d’une volonté de contrôle des individus ?
Tout au long de son livre, dont nous ne relevons ici que quelques grands traits, Pascal Clerc interroge nombre d’éléments de l’école rendus quasiment invisibles tant l’habitude nous les cache, et les remet sur le devant de la scène.
Franchissement : entrer dans l’école, devenir élève
En entrant dans l’école, en franchissant ses barrières qui sont souvent physiques – sous forme de grille par exemple – l’enfant se transforme : il devient élève. Il entre dans un espace avec ses propres règles, qui diffèrent de celles du monde extérieur : elles sont regroupées dans le règlement intérieur, et parfois explicitées dans la loi.
L’analyse de nombreux règlements intérieurs par Pascal Clerc révèle des consignes très coercitives, et qui n’existent parfois nulle part ailleurs : rasage quotidien pour les garçons, pas de boucle d’oreille pour les garçons, pas de cheveux détachés pour les filles… Quel est le sens, la logique de ces règles ? Quelle discipline cherchent-elles à instaurer ?
En entrant à l’école, l’élève entre dans un espace laïc régi par la loi : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève. » (Art. L. 141-5-1 du code de l’éducation).
Le concept même de laïcité est une source inépuisable de débat. Pascal Clerc rappelle que l’on peut différencier deux types de laïcité :
- la laïcité de tolérance : approche ouverte et inclusive envers les différentes expressions religieuses dans l’espace public visant à accommoder les diverses croyances et pratiques religieuses tout en maintenant la neutralité de l’État.
- la laïcité de combat : limitation de l’expression religieuse dans l’espace public et promotion d’une séparation plus nette entre l’État et la religion.
La loi du 15 mars 2004 montre que c’est plutôt une laïcité de combat que l’on retrouve à l’école, et on a pu l’observer lors de la rentrée de septembre 2023 avec les débats sur le port de l’abaya à l’école, désormais interdite. Mais que créent ces règles ? Pour Pascal Clerc, elles déclenchent exactement ce qu’elles souhaitent combattre : du communautarisme. Car en interdisant le port de l’abaya à l’école publique, les élèves qui veulent la porter iront dans des écoles communautaires.
Le test de l’uniforme (tenue vestimentaire commune), mis en place à la rentrée 2024, suit cette même logique : gommer les inégalités, uniformiser l’apparence. Cette tenue commune est officiellement “destinée à réduire les différences sociales, à lutter contre le règne de l’apparence et contre toutes formes d’inégalités et de prosélytisme”. Les règles strictes en matière de tenue vestimentaire réussissent-elles à remplir ces objectifs ?
En 1880 apparaissent les premières réglementations architecturales sur la construction des écoles. Pascal Clerc souligne l’une de ces règles : avoir des fenêtres dont le bas est au minimum à 1m20 du sol. De cette manière, les élèves assis ne peuvent pas voir le monde extérieur et ne peuvent donc pas être distraits.
Aujourd’hui, on observe une deuxième forme de fermeture sur le monde, dans l’autre sens : on n’entre pas n’importe comment dans l’école qui possède grille, gardien, caméras… Conséquence : la co-éducation (association des parents aux actions éducatives mises en place à l’école), si efficace pour un meilleur encadrement des enfants, est quasiment impossible en France où les parents sont rarement les bienvenus dans les établissements scolaires. En effet, les établissements scolaires sont de plus en plus fermés, particulièrement depuis 20 ans, et de manière plus visible depuis Vigipirate : les grilles aux nombreuses ouvertures sont remplacées par des portails opaques, les vitres obscurcies, pour que rien ne soit visible depuis l’extérieur.
À un besoin de sécurité, on a donné une réponse sécuritaire, dont Pascal Clerc interroge la légitimité. Car quelles sont les conséquences de cette fermeture sur les apprentissages ? S’est-on donné la peine de s’interroger là-dessus ? Pour Pascal Clerc, c’est de présence humaine dont les établissements ont besoin pour retrouver une sécurité qu’ils ont le sentiment d’avoir perdue. Il cite des établissements plus ouverts, fondés sur la confiance, ou la possibilité d’ouvrir les établissements hors du temps scolaire aux parents, aux habitants des quartiers etc. Cela permettrait une réappropriation de ces espaces et des synergies bénéfiques aux élèves comme à la société.
L’école : un espace clos, avec ses règles à part, qui exacerbe les tensions. Alors que c’est en confrontant nos différences dans la sphère publique que l’on apprend à vivre ensemble.
L’école : un lieu pour enseigner, ou un lieu pour apprendre ?
La dichotomie relevée par Pascal Clerc vient en partie du fait que, depuis leur origine, les établissements scolaires sont construits comme des lieux d’enseignement, et non des lieux d’apprentissage. Dans les années 1980, Guy Vincent, sociologue de l’éducation, élabore le concept de “forme scolaire”. Il montre comment, entre le XVIè et le XIXè siècle, se développe une forme scolaire et l’idée de créer un lieu qui s’appellerait “école” et qui rassemblerait les enfants par tranche d’âge pour leur enseigner un certain nombre de choses. L’idée est de les séparer des adultes, de les mettre dans des lieux dédiés à l’enseignement. Ceci est un grand changement par rapport à ce qui se faisait jusqu’alors : les enfants apprenaient justement au contact des adultes, souvent de leurs parents, ce qui donnait un système très genré et déterministe. C’est dans une perspective égalitariste, pour la diffusion d’un savoir de masse, que l’on a inventé l’école, dans un principe de séparation du monde des adultes.
Sur cette idée que l’extérieur est une perturbation, on développe à l’école un espace-temps spécifique : des sonneries toutes les 55 minutes, des déplacements d’une salle à l’autre, l’interdiction d’être dans certains endroits à certaines heures, un code vestimentaire spécifique. Michel Foucault dans Surveiller et punir a mis en avant l’importance de la surveillance dans la création des espaces scolaires. Si les cours de récréation n’ont pas été végétalisées plus tôt, c’est entre autres, car une cour entièrement plate et bitumée permet la surveillance de tous les élèves en même temps.
Les écoles ont été pensées comme un alignement de salles de classe où le professeur est face à ses élèves, et les autres types d’espace, les espaces interstitiels, (cour de récré, cantine, couloirs, toilettes…) ont été très peu pensés. Et ce sont ces espaces qui posent aujourd’hui problème dans les établissements scolaires.
La géographie de la salle de classe a pourtant une influence sur l’apprentissage. On n’apprend pas de la même façon dans une salle en autobus que dans une salle en îlots ou à l’extérieur, les dynamiques sont différentes. Réinterroger le cadre spatial de la salle de classe, c’est réinterroger sa fonction, d’enseignement ou d’apprentissage. De quels espaces ont besoin les élèves pour bien apprendre ? À l’heure où l’on essaie de prendre de plus en plus en compte les spécificités de chacun, cette question prend une place de plus en plus importante. Pascal Clerc cite notamment des expériences au Brésil, où les parents géraient le jardin et la bibliothèque de la classe, des forest schools en Allemagne et en Suisse, où l’on fait classe dehors, des walk and talk pour faire cours en marchant dans la cour : ces pédagogies permettent de ne pas nier le corps, mais au contraire de penser l’apprentissage dans un sens plus global, d’apprendre seul, par l’expérimentation, par les gestes du corps.
Pour une réinvention de l’école
En analysant l’école comme un lieu à la fois d’émancipation et de contrôle, Pascal Clerc propose une lecture fascinante des espaces scolaires. Ce regard critique invite à repenser les structures architecturales et organisationnelles pour mieux comprendre leur impact sur la dynamique d’apprentissage. La question sous-jacente reste essentielle : si l’école veut réellement préparer les enfants à s’ouvrir au monde, ne devrait-elle pas aussi repenser ses frontières physiques et mentales ? Mettre l’apprentissage au cœur de l’école passera par l’ouverture de l’école : une ouverture sur le monde, une ouverture dans les approches pédagogiques, une ouverture sur la remise en question de sa forme. Il faudra repenser le rôle de l’enseignant, qui n’est plus le seul détenteur du savoir à l’heure d’internet, et oser une éducation plus globale, qui prend en compte les sens et qui se confronte au-dehors.
POUR ALLER PLUS LOIN
Les candidatures pour rejoindre le programme sont ouvertes ! Déposez votre dossier en ligne pour enseigner au primaire, en collège ou en lycée professionnel dès septembre 2025 avec Le Choix de l’école.